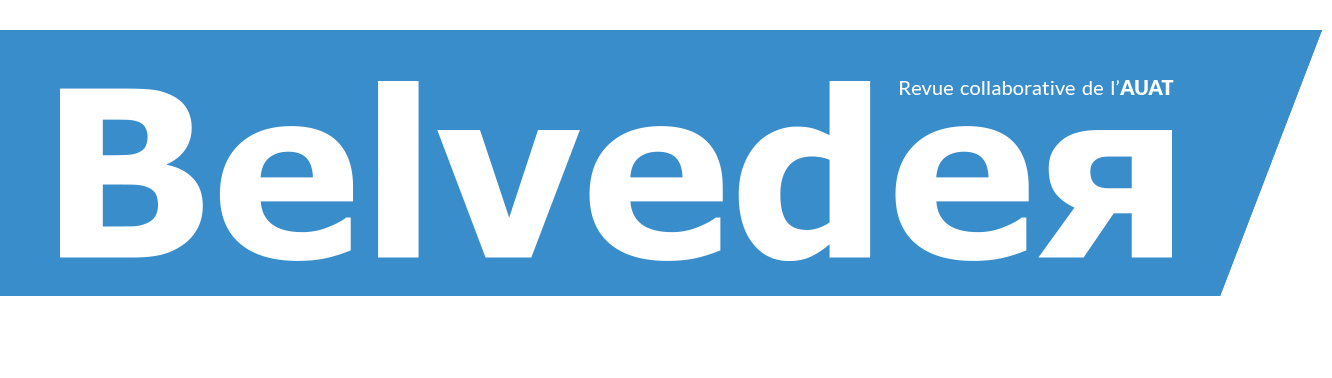Téléchargez l’article au format PDF
Loïc GEINDRE
Directeur d’études et gérant de la Coopérative Place
Hervé Castelli
Directeur d’études à la Coopérative Place, Professeur associé à l’Université de Bordeaux Montaigne et Sciences Po Bordeaux
Comment avoir une bonne connaissance du sans-abrisme ? Combien de personnes sont concernées ? Quels sont leurs profils ? Quels parcours les ont menées au sans-abrisme ? Dans quelle situation vivent-elles ? Autant de questions auxquelles les statistiques disponibles ne peuvent aujourd’hui pleinement apporter de réponses, faute de données précises, territorialisées et suivies dans le temps . Autant de connaissances pourtant nécessaires pour « mettre fin au sans-abrisme à l’horizon 2030 », ambition affichée par l’Union européenne dans la Déclaration de Lisbonne de 2021, et déclinée en France à travers l’objectif « zéro personne à la rue ».
Un travail de terrain, la rencontre de personnes sans-abris, d’associations et d’élus permettent de compléter les données statistiques pour objectiver et comprendre les situations de sans-abrisme. Celles-ci se sont largement complexifiées et diversifiées en raison de l’intensification des migrations, mais aussi de la conjugaison de ruptures sociales et de tensions sur le marché du logement. Observer pour prendre la mesure des enjeux est donc la première étape de toute politique publique. Les travaux des observatoires locaux du sans-abrisme permettent ainsi d’agir, d’anticiper les dynamiques à venir, de consolider les stratégies publiques, de coordonner les actions, d’en imaginer des nouvelles. Bref, de renforcer l’accès au logement… d’abord !
La coopérative Place a mené une étude sur le sans-abrisme dans la métropole bordelaise en 2022, basée notamment sur un travail de terrain et d’entretiens. Celle-ci révélait qu’environ 4 800 personnes y étaient sans domicile, auxquelles s’ajoutaient 7 200 personnes exposées à un risque de bascule, faute de sécurité résidentielle, hébergées de manière informelle chez des tiers. Soit près de 12 000 personnes qui, sur la métropole bordelaise, ne disposaient pas d’un logement pérenne, confirmant ce que les acteurs de terrain qualifient de « tsunami social » depuis la crise du Covid-19. Au-delà des chiffres mis à jour par cette étude, le travail de terrain réalisé a permis de mettre en évidence dix profils de personnes sans-abris et trois mécanismes mettant à l’épreuve les valeurs d’un territoire attentif aux situations et à la place de chacun, à ce qui fait hospitalité et cohésion sociale.
De qui parle-t-on ?
Selon l’Insee, une personne est considérée comme sans domicile « si la nuit précédente, elle a eu recours à un service d’hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de fortune) ». Cette définition, partagée par les acteurs de terrain, intègre la notion de parcours résidentiel chaotique, où se succèdent les situations de rue, d’abri temporaire, de squat ou de logement chez un tiers – mais toujours sans ancrage stable, sans « chez-soi ».
Les décrochages liés aux ruptures sociales
Les causes qui mènent au sans-abrisme sont souvent liées à des ruptures professionnelles (perte d’emploi, déclassement, abandon d’études), familiales (séparation, violences, fugue), sanitaires (addictions, troubles psychiatriques, handicap), institutionnelles (sortie de prison, hôpital, foyers) ou juridiques (fin de prise en charge ASE, contrats jeunes majeurs, mesures de protection…), ou plus simplement à la perte de logement (expulsion…). Ces ruptures s’alimentent entre elles, usent les personnes et renforcent leur isolement.
Les jeunes en errance
Plusieurs facteurs expliquent la présence de jeunes de moins de 30 ans dans la rue, notamment la fin de la prise en charge de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ce passage peut s’accompagner d’histoires dramatiques, et certains basculent dans des situations inquiétantes où se cumulent diverses problématiques (psychologiques, addictions…). Accompagnés, pour certains, de leur chien, dont le rôle oscille entre report affectif et protection réelle, ces jeunes en errance recherchent des alliances protectrices, des « frères et sœurs de rue ». Dans la journée, ils choisissent un spot à Bordeaux-centre où la manche est plus facile, avant de prendre le tram pour dormir dans un lieu plus sécurisant. L’été, la vie de « teufeurs » (vie en camion, festivals, free party) en éloigne certains de la ville.
Les personnes vieillissantes
Chroniquement installées dans la rue, de jour comme de nuit, elles peuvent souffrir d’une addiction qui les assigne à un lieu (marché des Capucins, gare, Palais des sports…). Elles s’installent proche de supérettes qui font crédit le jour, et de lieux où se mettre à l’abri la nuit (parkings, laveries, devantures, recoins d’immeubles, de petites rues…). Éloignées des dispositifs d’urgence, elles peuvent trouver refuge à certains moments dans des petits hôtels privés qui jouent un rôle social très utile, mais qui disparaissent progressivement. Les personnes du réseau de professionnels, qui ont su tisser avec elles une relation patiente, attentive et respectueuse de leurs droits, sont un soutien utile.
Les femmes seules ou avec enfants
Elles sont de plus en plus présentes dans la rue, les foyers ou les squats. Les filets de sécurité disparaissant progressivement, celles qui se tenaient tant bien que mal à l’écart de la rue s’y retrouvent poussées pour diverses raisons : pauvreté, précarité, violences conjugales, séparation, migration, soucis de santé… Des nuits d’hôtel financées notamment par l’État, le CCAS et le Département (compétence supplétive à l’État pour les mères enceintes et/ou avec enfant de moins de 3 ans) permettent des mises à l’abri des mères avec enfants. Certains squats dédiés aux femmes jouent également un rôle dans l’accueil de ce public. Au-delà du logement, ces mères, migrantes ou non, ont de gros besoins en termes de soins et de soutien (puériculture, parentalité, écoute…), sachant que la plupart « échappent au 115 ».
Les invisibles, des individus discrets
La recherche de discrétion et d’anonymat dicte leur conduite. Suite à une rupture (familiale, emploi, santé…), ils sont coupés de leurs anciens réseaux, qu’ils ont mis à distance. À moins que cela ne soit le contraire. Soucieux de préserver leur apparence (hygiène, vêtements), ils identifient des « interstices » pour se loger, comme des petits espaces collectifs (loge, entrée d’immeuble, microlocal), un garage ou le logement d’un propriétaire absent ou décédé. Ils repèrent des volets fermés, souvent en périphérie, avant de trouver les clés (« sous un pot de fleur ! ») ou de pousser (« un peu fort ») la porte d’entrée. Ils savent se rendre utiles vis-à-vis de leur environnement et de leur voisinage. En sortant les poubelles dans une copropriété, par exemple, en échange du « silence » et de la compréhension de leurs voisins. Ils trouvent ainsi le moyen de gagner leur vie, ou plutôt leur survie, sans réel accompagnement social. Ces personnes ne sont ni repérées, ni repérables, par les services compétents. Certaines sont passées par la rue et des squats, qu’elles ont fuis face à leur violence et leurs tensions, liées aux expulsions permanentes.
L’horizon bouché du logement
Dans un contexte de tension immobilière, le travail ne garantit plus un logement. Le parc locatif privé reste inaccessible pour les personnes à faibles ressources (caution, loyer élevé), et le logement social souffre de délais d’attente et de rigidités administratives. À Bordeaux Métropole, malgré 3 000 logements sociaux construits chaque année dans le cadre du PLH, les besoins explosent. Ainsi, les travailleurs pauvres, les saisonniers, les étudiants, les apprentis, dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, constituent une figure de plus en plus prégnante parmi les publics du sans-abrisme (et du mal-logement). Le logement constitue un poste inaccessible qui doit être sacrifié et compensé par des solutions de repli.
Les étudiants, stagiaires en formation et apprentis
De nombreux étudiants, notamment boursiers ou étrangers, commencent l’année sans logement. Malheureusement, cette période « chaude » s’étire de plus en plus. Elle les amène à bricoler toutes sortes de solutions : des nuits chez un « ami », une chambre Airbnb, un campement sauvage, une voiture, un squat, un camion… On ne compte plus les systèmes de débrouille en attentant un logement plus pérenne, quand il se libère via le CROUS, les résidences Habitat Jeunes ou le marché privé. Certains finissent par rentrer chez leurs parents, en abandonnant leurs études bordelaises.
Les travailleurs pauvres
Attirées par les opportunités de travail dans la métropole bordelaise, des personnes viennent s’y installer pour des périodes plus ou moins longues, en fonction de la durée de leur contrat de travail (beaucoup en intérim ou en emploi saisonnier). Essentiellement des hommes jeunes, ils vivent parfois dans leur voiture, pour économiser et parce que le parc privé (caution, coût) ou public (délais, contraintes administratives) leur est difficilement accessible. Ils trouvent une place gratuite pour garer leur voiture en périphérie, à proximité de leur lieu de travail, d’un parc et d’un point d’eau (gymnase, WC, cimetière, aire d’autoroute) et d’électricité (pour recharger les téléphones). Ils alternent avec des nuits d’hôtel peu onéreuses en bordure de rocade, voire un Airbnb, pour un accès aux douches et à un confort réparateur.
L’intensification des migrations
Les personnes migrantes représentent aujourd’hui une fraction importante du sans-abrisme. Elles font l’objet de nombreux amalgames qui renvoient à des raccourcis, alors même que leurs parcours, leur statut juridique, leurs expériences et leurs ressources varient, et influencent fortement leurs droits et leurs trajectoires.
Les demandeurs d’asile
Une part importante de ces personnes (majoritairement des Albanais, Géorgiens, Syriens et Afghans en 2019) peut être hébergée dans les places disponibles du DNA (dispositif national d’accueil des personnes demandant asile). Une fois l’instruction de leur demande d’asile terminée (6 à 18 mois), les titulaires du statut de réfugié sont inscrits comme prioritaires dans la longue liste d’attente des demandeurs de logement social, sans pour autant que cela leur garantisse un logement. Celles qui sont déboutées du droit d’asile et soumises à l’OQTF (obligation de quitter le territoire français) disparaissent, en espérant réapparaître dans 5 ans, pour renouveler leur demande. Les places d’urgence ou les nuitées d’hôtel permettent parfois des moments de répit qui sont largement complétés par des initiatives citoyennes informelles, de particuliers et de collectifs militants.
Les mineurs non accompagnés (MNA)
Nombre de mineurs étrangers isolés, sans référent légal et potentiellement en danger, errent sans solutions, de squat en squat, notamment ceux qui n’ont pas encore fait l’objet d’un diagnostic sur leur âge. Si leur demande de prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance est rejetée (reconnaissance ou non de minorité par le Département), ces jeunes devenus sans-papiers mobilisent des solutions précaires, fondées sur l’invisibilité, et se retrouvent exposés à des réseaux violents de malfaiteurs.
Les familles bulgares et roumaines
Ces citoyens européens de langues et religions diverses (turcophones et musulmans, romani et évangélistes…) quittent la précarité et les discriminations de leur région d’origine pour de meilleures conditions de vie avec un travail mieux rémunéré en France. Le travail dans l’emploi saisonnier du BTP ou des activités agricoles, ou dans la mendicité, leur permettent d’amasser un pécule et d’ouvrir leurs droits (permis de travail, santé, école). Ils vivent souvent dans de « gros squats » (de 100 à 400 personnes), rythmés par de réguliers aller-retours dans leurs pays d’origine et de régulières ouvertures et fermetures de squats. Leurs projets et leurs conditions d’« installation / intégration » méritent d’être envisagés avec d’autres lunettes, comme en témoignent les dispositifs spécifiques logement temporaire d’insertion (LTI) / espace temporaire d’insertion (ETI), sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole.
Les migrants économiques
Ce sont le plus souvent des hommes qui ont quitté un pays dans l’espoir d’une vie meilleure pour eux et leur famille. Ils arrivent en France à la recherche d’un emploi qu’ils comptent trouver grâce à leur communauté et leurs réseaux. Ils s’inscrivent dans une immigration professionnelle et traditionnelle, prolongée ou non d’un regroupement familial. Ils occupent en général des « métiers difficiles à pourvoir » dans le secteur du bâtiment ou de l’agriculture, à la frontière de la métropole (Médoc, Libournais…). Munis d’un contrat de travail, ils espèrent ouvrir des droits (permis de travail, santé, logement, famille). En attendant, ils trouvent et s’installent dans des solutions ultraprécaires. La défaillance de certains employeurs, ou celle de « filières de recrutement » plus ou moins légales, renvoient ces migrants à des conditions de mal-logement avérées (logements suroccupés, caravanes, tentes, squats).
© Noée Geindre